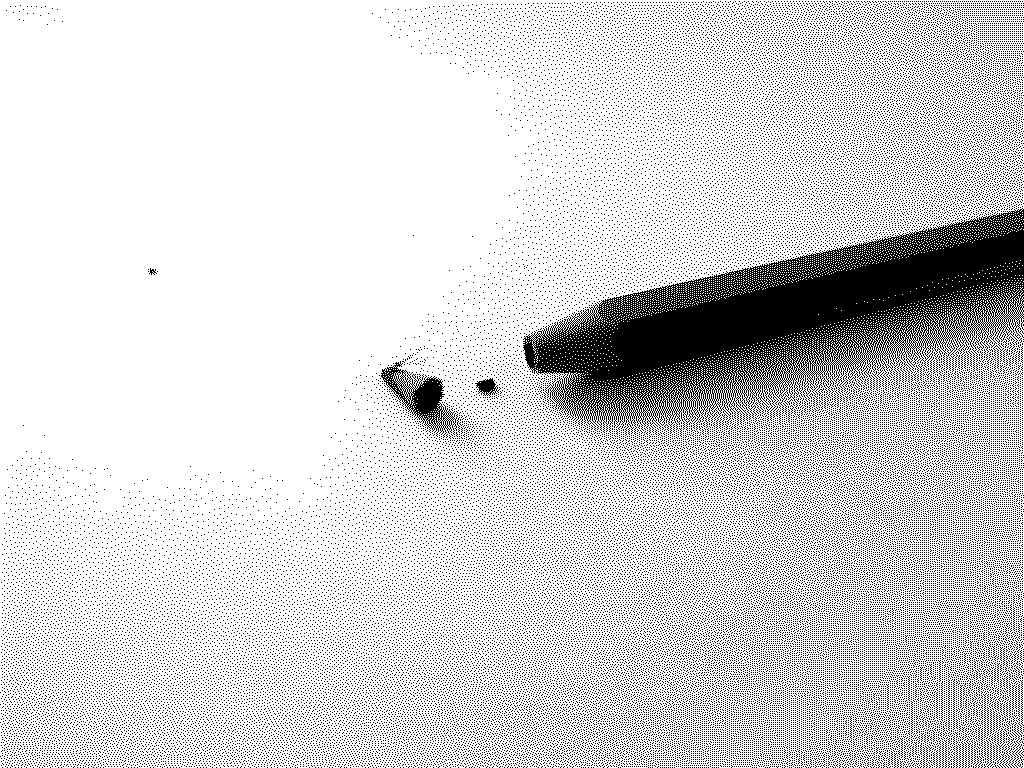
L’artiste plasticien est un créateur d’images, de formes et d’objets en tout genre. Il reproduit, invente, retranscrit et/ou transforme une réalité, en crée une autre, une parallèle, qui trouve son essence à travers le prisme de ses émotions. Cette pratique lui permet (parfois) d’être vu, lui et son œuvre, d’être apprécié, voir adulé, d’être mis en avant, devant son œuvre ou même derrière, peu importe, cette visibilité est certainement agréable et la réussite qui va avec également, certainement.
Néanmoins, pour certains, cela ne suffit pas. L’art est avant tout une thérapie, un moyen de s’équilibrer, de se forger et de se guérir. Et puis, la reconnaissance ne suffit plus, le fruit de l’œuvre n’ayant aucune importance, car seule l’oeuvre et le message qu’elle véhicule n’a d’importance. Ils veulent passer un message fort, avoir un impact fort, socialement et intellectuellement. L’art n’est alors plus qu’un outil, un moyen pour élever les consciences, pour changer le monde, une utopie... Et puis, l’image ne suffit plus.
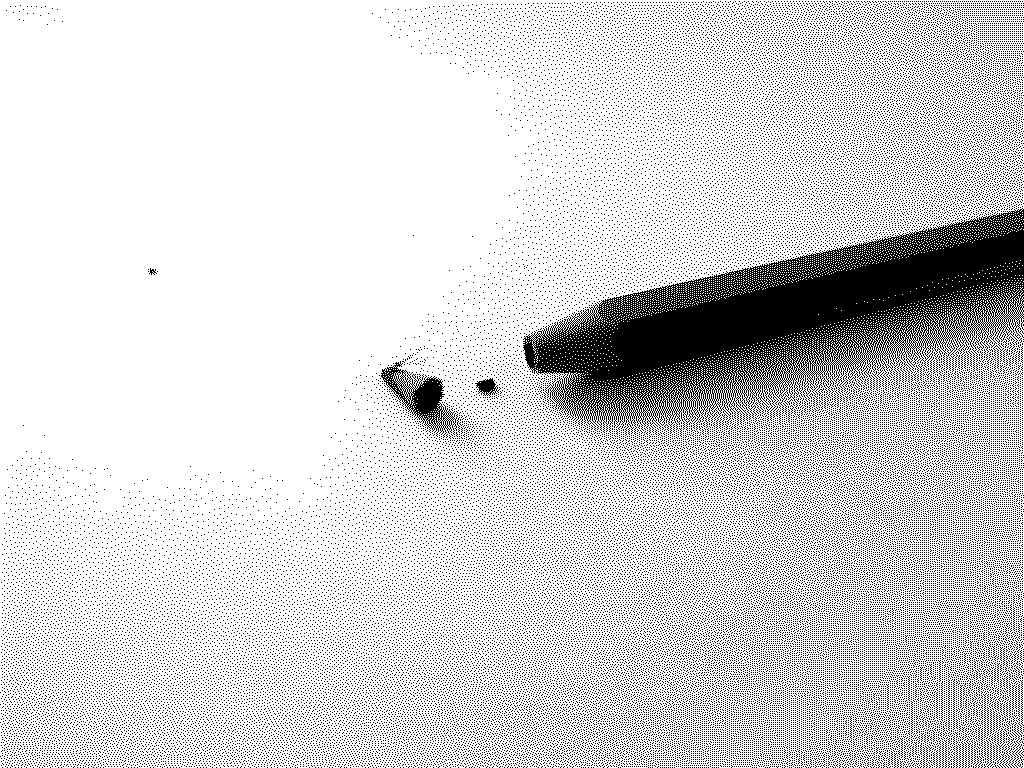
Progressivement, mais inéluctablement, voici l’avènement d’une révolution personnelle et publique totale.
Alors que s’évanouit l’artifice de faire œuvre et, par son simulacre mythologique, de laisser une trace pour les générations futures, que s’effrite l’importance allouée à cette même œuvre, qui en fin de compte, n’a d’importance que dans l’imaginaire de son géniteur, la courbure du virage est d’autant plus raide qu’elle dessine l’ampleur de la tâche à effectuer. Nous parlons ici d’un profond changement de paradigme individuel, d’une fracture de trajectoire ou, privé de ses béquilles, l’artiste n’a d’autres alternatives que de s’effondrer.
S’offre à lui, alors, la possibilité d’une fragilité tragique, concrétisée par la tentation d’une persévérance picturale qui, in fine, le conduira irrémédiablement vers une forme d’autolyse esthétique.
Si l’art - devenu uniquement routine de la maîtrise, est produit de façon quasi-industriel, mécaniquement, il acquiert le pouvoir de modeler la condition initiale, l’intention primale, qu’il dépossède par le prélèvement progressif de fragments plus ou moins importants, ou par l’accumulation de signes et de symboles, sorte de fioritures référentielles qui s’auto-alimentent à outrance, pour générer un emballage poreux de surface qui se substitue à la profondeur, jusqu’à saturation par infiltration, jusqu’à le réduire à un ennui technique défaillant. L’art devient de surcroît une dysfonctionnalité pesante, pleinement purgée de son essence, une sorte d’objet informe, semblable à une espèce unicellulaire, programmée pour la génération de vide par soustraction/accumulation.
En effet, les œuvres dans lesquelles l’artiste pouvait se réfugier, ne sont plus qu’une source obscure de souffrance. Pire, vides de toute substance, elles ne sont que la répétition désespérée d’autres œuvres délavées. Là où elles furent longtemps une forme de repli salutaire pour échapper à la condition initiale, par effet papillon, elles n’aboutissent plus qu’à une situation proche du chaos.
Dans la mesure où l’art amène à être considéré comme une chose pratiquée dans un but précis, une praxis profondément personnelle, du domaine qui relève de l’intérieur, que l’on peut identifier de métaphysique thérapeutique et qui ne prend en compte - depuis sa gestation, d’aucune considération marchande, l’apparente guérison transcendante engendre alors, de façon systémique, un désir d’abandon progressif du traitement placebo, qui sans efficacité pharmacologique avérée, n’a plus lieu d’être. Si l’art est donc perçu comme le traitement d'une défaillance - semblable à une pathologie, l’évolution positive de toute situation nécessite à un certain stade, une purge curative. L'exemple le plus frappant de cet usage de curable et de curatif est représenté par la disparition consécutive à l’arrêt volontaire du traitement, c’est-à-dire de l’abandon de toute représentation artistique, tant dans l’incarnation que dans la fonction.
En partant de cette constatation, nous pouvons admettre raisonnablement que si des décennies artistiques passées ne se réduisent qu’à un processus de rémission en vue d’une guérison complète, l’absence de symptômes a valeur de preuve irréfutable de l’inutilité de poursuivre toutes pratiques artistiques sous peine de dégradation volontaire d’un état que l’on peut considérer en toute honnêteté comme sain.
De plus, la guérison d’un état compulsif engendre un vide qui ne peut être comblé par un autre vide, par un art voué à la répétition infinie, un art qui tourne en rond... Parce que l’art automatisé ne propose aucune porte de sortie à la machine nouvelle qui le produit, l’esthétique ancienne s’inscrit dans un système de valeurs qui tourne en cercle fermé. Le produit mythologique n’est plus qu’un discours creux qui peut encore séduire l’autre, mais qui s’éloigne graduellement de son créateur. Alors, on peut concevoir le créateur comme étant un moyen fonctionnel pour l’art d’injecter du néant dans l’art.
Réciproquement, le changement des mécanismes de la création liée à l’évolution technologique, combiné à l’appauvrissement substantiel des œuvres et des thématiques abordées par accumulation, absorptions et répétition, ainsi que la disparition de la dimension mystique de toutes les créations, engendre une accumulation de perturbations qui ont tendance à creuser certaines cicatrisations. Du noyau, s’échappe alors une excroissance cellulaire métastatique qui risque de gangrener l’ensemble du sujet en rémission. Dans une certaine mesure, l’obstination, pour des raisons d’équilibre, d’habitude, d’apparat ou de posture, ne serait alors que le signe d’un processus d’autodestruction.
La sur-production d’images entièrement dévouées à la célébration du culte de l’hyperprésence, de la projection narcissique et de la transformation d’un réel fantasmé, engendre une véritable saturation visuelle dont le seul avantage serait, à condition que le mirage n’englobe pas tout, de mettre en évidence quelques rares traces de l’absence. L’image, sorte de défection continuelle, qui de sa production à sa consommation n’a plus à offrir qu’une aliénation spectaculaire, produite par des systèmes tout autant spectaculaires, qui ne demandent plus aucune compétence esthétique et technique, serait alors par son obésité, la condition salutaire pour une mise en lumière de l’absence. En somme, l’œuvre ne serait présente que par son absence et n’aurait de valeur que par son refus de connivence avec cette même présence. La disparition comme unique moyen d’exposition.
L’injection de la mystique dans l’art est anachronique. Toute tentative contemporaine est vouée à plonger l’œuvre dans la désuétude. Notre époque est profondément réfractaire à la mystique. Elle ne porte son attention que sur sa symbolique hygiénique, souvent au sein de structures sociales versatiles en quête de consommation de sens. Dépouillé de sa mystique, l’art n’est plus qu’un objet consommable, hors du champ des valeurs, happé par un modèle déconnecté de toute possibilité de partages et d’échanges hors de son propre dispositif, un système clos qui, comme pour la maîtrise, est destiné à n’être qu’un accélérateur de vide par soustraction/accumulation.
Si la création est réduite à une production vouée à une mort lente et méthodique, la mise en place des conditions de l’effacement volontaire dans le but d’atteindre l’absence artistique est alors l’unique possibilité salutaire.
Songeons aussi que derrière cette renonciation, ne représentant en aucun cas une disparition définitive autre que celle de la dimension artistique du sujet, qui par abandon de sa condition d’artiste et de toutes les pratiques/habitudes/pathologies liées à ce statut, s’offre un champ des possibles pour l’adoption d’un avenir – plus précisément la projection d’un futur, bien plus en phase avec ses attentes. En s’offrant la possibilité d’abandonner le personnage qu’il présente au monde, de rompre avec les automatismes et les habitudes, d’inhiber le jeu des miroirs et des impostures, nous parlerons alors d’une reconversion incluant un schéma moins grandiloquent, ou, quel que soit son mode d’efficience, à l’écart de tout tumulte et de toute exposition, l’individu pourra jouir d’une capacité démultipliée afin d’obtenir de nouveaux résultats dans d’autres domaines que la représentation esthétique.
L’art n’est en aucun cas un moyen de lutte ou d’influence sociale. En revanche, la rupture peut attirer l'attention et déboucher sur une trajectoire plus propice à résoudre les problèmes sociaux et environnementaux les plus pressants.
L’idéologie de cette société n’a que peu de place pour ceux qui sont adeptes de ruptures. Elle n’encense que des modèles de dynamique ininterrompue, laissant ainsi à la marge tous ceux qui se déplacent de travers et provoquent des failles d’incertitudes. La cessation d’activité est mal perçue par un système qui promeut exclusivement la fulgurance financière et spéculative.
En s’obstinant, l’artiste entre dans une spirale de connivence définitive avec le système publicitaire marchant, avec ses signes sociaux (hiérarchisation, statut, appartenance par mimétisme, par possession…), avec ses codes capitalistes qui matériellement s’accumulent tout en amoindrissant l’intellect, validant ainsi sa soumission au détriment d’une vision initiale qui se voulait certainement plus introspective et rédemptrice.
L’argent, la plus destructrice de toutes les servitudes. Cette démarche d’abandon, d’un point de vu matériel – au sens capitaliste du terme, demande forcement des conditions de réalisation. Il en va à chacun de les mètrent en place, ou pas. Là, n’est pas le sujet profond de cette réflexion.
Prendre ses distances n’est ni une fuite, ni un échec. Au contraire, cela demande du courage, de l’acceptation, de la résilience et de l’engagement, ainsi qu’une réelle vision.
De la thérapie à la « réussite artistique et sociale », de l’engagement à la rupture, par paliers successifs, une trajectoire se dessine : celle d’un artiste qui a pris progressivement ses distances avec le milieu de l'art et a intentionnellement mis fin à sa carrière artistique pour explorer de nouveaux horizons. Libéré de toutes les contraintes liées à son ancienne activité, il peut enfin jouir d’une monotonie bienveillante.
Même si un artiste reste toujours un artiste, il est temps pour lui de résister à ce système d’obsolescence. La rupture est loin d’être une faillite, c’est une soustraction salutaire qui crée une absence et, il y a bien plus de présence dans l'absence et de beauté dans l'achèvement.
— 01/01/2025